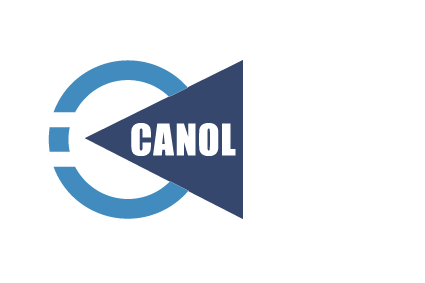Une société d’économie mixte (SEM) est une société privée avec une majorité de capitaux publics (entre 50 % et 85 %).
Pour la reconstruction après la seconde guerre mondiale, de nombreuses SEM ont été créées sous l’égide de la Caisse des dépôts. La première avait une activité de construction et gestion de logements sociaux, la seconde d’aménagement (ZAC, communications, parkings…) et d’ingénierie, avec ses filiales (dont Scetauroute devenue EGIS), et son réseau de SEM d’aménagement (une centaine) dont la SERL.
La loi de décentralisation de 1982 a donné de l’envergure au dispositif, en utilisant les SEM pour leur souplesse, car de droit privé. Leur nombre a considérablement évolué et leur objet également, bien que théoriquement limité aux compétences de leur collectivité de rattachement.
SCIC Habitat est actuellement un bailleur social majeur, et le réseau SCET est devenu un prestataire de conseil aux collectivités, activités ne représentent que le tiers du total des SEM.
Deux évolutions réglementaires ont accompagné ces changements, réduisant à peau de chagrin l’intérêt des SEM :
- Lorsque les collectivités passent un contrat d’AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage), de conduite d’opération, elles sont obligées de mettre en concurrence les opérateurs.
- Lorsque les SEM passent des contrats (maîtrise d’œuvre, travaux…) pour le compte des collectivités, elles doivent appliquer les règles de passation du code des marchés publics des collectivités bien que leurs marchés soient privés.
Il a alors été créé à titre expérimental les SPLA (sociétés publiques locales d’aménagement) dont le capital est à 100% public, qui ont été pérennisées et assouplies, devenant les SPL à activités élargies. Leur principal intérêt est de bénéficier de contrats « in house », c’est-à-dire sans mise en concurrence de la part de leur collectivité actionnaire majoritaire.
Ont été créées également les SEMOP (sociétés d’économie mixtes pour une opération unique), permettant de choisir l’actionnaire privé.
L’histoire des SEM montre une lutte incessante entre les collectivités qui souhaitent une liberté de gestion de l’argent public (!) et les défenseurs des directives européennes qui visent à maintenir une relative rigueur dans la gestion publique.
Un exemple récent des dérives permises par les SEM est l’opération de construction du Musée des Confluences. La SERL s’est vu confier sans mise en concurrence le mandat de la maîtrise d’ouvrage. Elle est responsable de la catastrophe financière et, n’ayant pas respecté son contrat, elle a été « sanctionnée » par une multiplication par 2,5 de sa rémunération. En fait, les décisions ont été prises par le conseil général, la SERL servant de faux nez !
Dans un rapport de mai 2019, la Cour des Comptes critique sévèrement le fonctionnement des SEM, et en particulier leur manque de transparence criant. Les SEM restent donc un outil incontournable pour les magouilles.
Pour ceux qui souhaitent accéder au rapport de la CDC :
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-societes-deconomie-mixte-locales